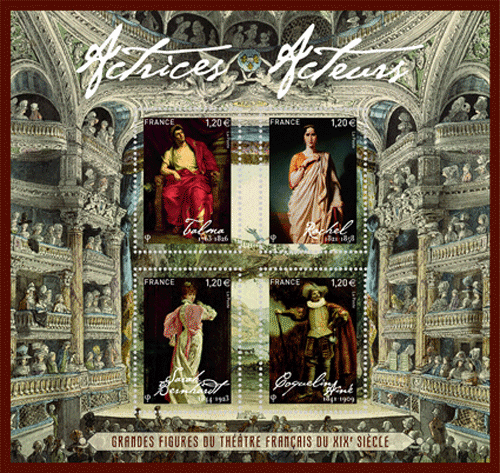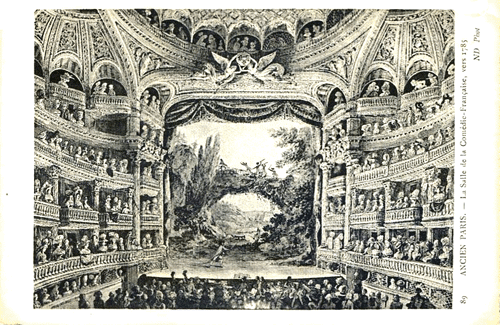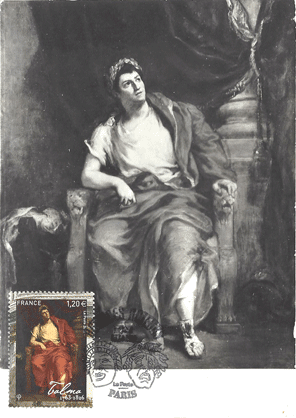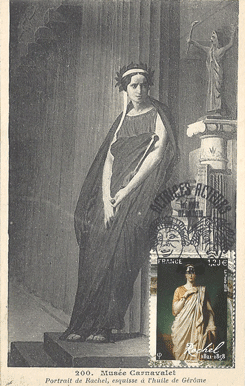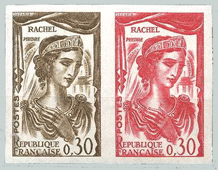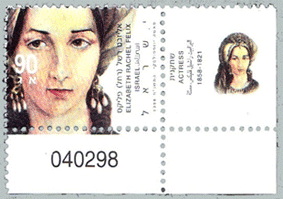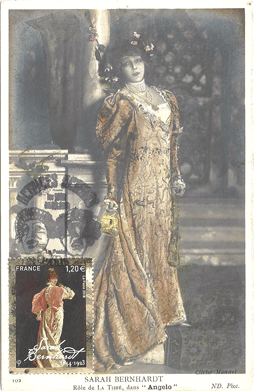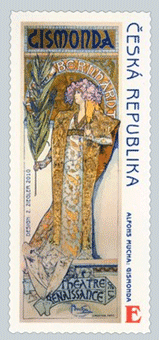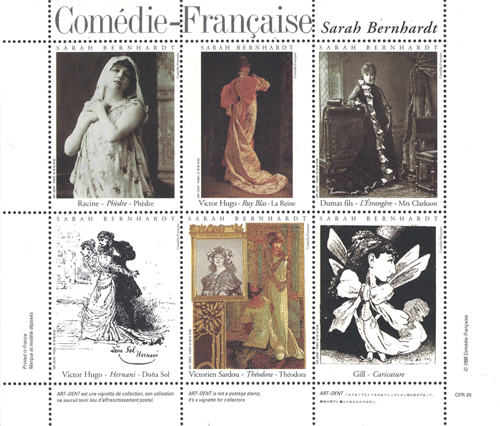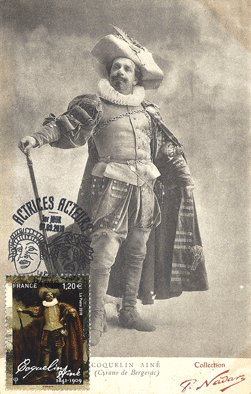LES ACTEURS
DU THEATRE DE HUGO
partie 1/2
articles parus dans les Bulletins n°136
et 138 du Club Philatélique de Vélizy-Villacoublay
et dans le n°17 de L'ECHO HUGO (2018), Bulletin de la Société
des Amis de Victor Hugo
Actrices
- Acteurs
Le 10 septembre 2018, La Poste
a émis un bloc de 4 timbres de la série "Actrices, Acteurs"
représentant en pied :
Rachel (1821-1858), Sarah Bernhardt (1844-1923),
Coquelin Aîné '1849-1909), Talma (1763-1826).
Ces acteurs, à
l'exception de Talma, ont tous interprété des rôles dans des
pièces de Hugo.
Le bloc
est illustré par les portraits peints et figurés en pied de Rachel,
Sarah Bernhardt, Coquelin Aîné et Talma. Ils sont ainsi figés
dans l'action et dans l'interprétation d'un de leurs rôles. Ces 4
acteurs ont fait carrière ou débuté à la Comédie-Française
et sont placés sur un fond de scène historique de la Comédie-Française,
l'actuelle salle (estampe de la fin du XVIIe siècle) où la troupe
menée par Talma s'installe définitivement en 1799. Le XIXe siècle consacre l'acteur comme vedette. Seules quelques personnalités suscitent un tel engouement : le public se précipite au théâtre lorsqu'elles paraissent, que ce soit en France ou à l'étranger, dans les tournées internationales qui les mènent jusqu'en Russie, et aux États-Unis à la fin du siècle. Talma, Rachel, Sarah Bernhardt et Coquelin aîné font carrière à la Comédie-Française, premier théâtre de France.
|
TALMA
: François Joseph Talma. [Si
l'on croit Adèle Hugo, son mari aurait pensé à Talma en écrivant
Cromwell.
Talma
réforme la scène sous la Révolution en adoptant [la toge
à l'antique pour la tragédie classique, costume que Delacroix reprend
dans son portrait de l'acteur incarnant le Néron de Britannicus de
Racine] l'esthétique néoclassique et la toge à l'antique
pour la tragédie classique, costume que Delacroix reprend dans son portrait
dans le rôle de Néron de Britannicus de Racine. |
RACHEL
: Elisabeth Rachel Felix. Elle
interpréta le rôle de " Thisbé " dans " Angelo,
tyran de Padoue" au Théâtre Français, le 18 mai 1850.
Rachel, issue d'une famille très modeste, fait figure de prodige. Édouard Dubufe la représente dans un de ses rôles favoris : Camille dans Horace de Pierre Corneille. Dès ses premières représentations, le public afflue comme jamais pour l'admirer dans la tragédie classique. Pour le peuple, elle parvient à incarner la République par son interprétation de La Marseillaise, pendant la Révolution de 1848. Seconde fille des six enfants de Jacob et Esther Félix, marchands ambulants, elle grandit dans la misère, vivant la vie errante et incertaine des nomades jusqu'à ce que ses parents viennent se fixer à Paris. Inscrite au cours de déclamation de Saint-Aulaire - qui va lui donner son nom de scène -, elle s'y fait remarquer par sa distinction naturelle et sa prodigieuse mémoire. Admise au Conservatoire, elle n'y reste que fort peu de temps, préférant un engagement au Gymnase où elle débute dans La Vendéenne de P. Duport. Elle se rend très vite compte qu'elle n'est pas faite pour ce répertoire-là. Samson, qui l'a prise comme
élève, la forme pour la tragédie. Son grand mérite
de professeur aura été de développer harmonieusement les
qualités innées de cette élève douée, mais
sans formation ni culture. Lorsqu'en juin 1838, il obtient qu'elle débute
à la Comédie-Française, elle est mûre pour le succès.
Ses débuts dans Camille d'Horace, Émilie de Cinna,
Hermione d'Andromaque et Aménaïde de Tancrède,
bien que situés à une époque de l'année peu favorable,
sont salués par un enthousiasme délirant (Jules Janin et Alfred
de Musset notamment couvrent d'éloges la débutante) et les recettes
se mettent à monter.
Bien qu'elle soit plutôt petite et maigre, assez insignifiante, la technique infaillible enseignée par Samson permet à Rachel d'exprimer avec force le feu intérieur dont elle brûle, à tel point qu'elle est transfigurée et brille en scène d'une étrange beauté. Elle réussit, poussée par sa famille, à obtenir des conditions financières exceptionnelles à la Comédie-Française. Dès lors, grande prêtresse de la tragédie classique, dont le renouveau accompagne le déclin du drame romantique, elle établit une sorte de dictature au sein de la troupe. Elle joue successivement, et avec un bonheur toujours grandissant, toutes les héroïnes de la tragédie : Roxane (Bajazet), Esther, Laodice (Nicomède), Pauline (Polyeucte), Chimène (Le Cid), Phèdre (qui correspond, en 1843, au sommet de son art et de sa carrière), Bérénice, Isabelle (Don Sanche d'Aragon), Athalie, Agrippine (Britannicus)...
Elle crée quelques drames modernes,
écrits pour elle : Virginie de Latour de Saint-Ybars, Adrienne
Lecouvreur de Scribe et Legouvé (un triomphe !), Judith de Madame
de Girardin, etc. Elle émeut profondément dans la Marie Stuart
de Lebrun, s'essaie au drame romantique, que pourtant elle apprécie peu,
avec Mademoiselle de Belle-Isle d'Alexandre Dumas et Angelo, tyran de
Padoue de Victor Hugo (en 1850). Elle
joue peu la comédie (célimène au cours d'une tournée
à Londres en 1847) et un petit acte pseudo-antique fait sur mesure par
Barthet (Le moineau de Lesbie). |
Sarah
BERNHARDT : Henriette Rosine Bernard Interprète de "
la Reine " dans " Ruy-Blas " en 1872 puis 1897 et de "Dona
Sol" dans " Hernani " en 1877, à la Comédie
Française ;
Sarah Bernhardt reste quelques années à la Comédie-Française comme interprète des jeunes premières du répertoire classique, moderne et romantique. Victor Hugo lui rend hommage pour son interprétation de la Reine de Ruy Blas, sujet du portrait peint par Georges Clairin. Se pliant difficilement à la discipline de la troupe, elle la quitte et dirigera plusieurs théâtres parisiens. Engagée en 1862 à
sa sortie du Conservatoire, où elle a reçu les cours de Provost,
Samson et Regnier, elle quitte presque aussitôt la Comédie-Française,
après un différend avec une sociétaire. À l'Odéon,
elle fait ses classes et conquiert la célébrité avec son
interprétation du rôle travesti de Zanetto dans Le Passant de
François Coppée (1869), puis avec celle de la Reine dans Ruy
Blas de Victor Hugo (1872).
La création
de L'Aventurière d'Émile Augier et les critiques défavorables
qui s'ensuivent consacrent sa rupture, déjà entamée, avec
la Comédie-Française. Elle quitte définitivement la Maison
de Molière et poursuit à Londres, en Amérique et à
Paris la carrière triomphale que l'on sait. Ses excentricités, ses
dons multiples (elle sculpte et elle écrit) en font, avant la lettre, une
" star " de réputation internationale.
| |||
COQUELIN
Aîné : Benoît Constant Coquelin Joua le rôle de Don César dans " Ruy-Blas " à la Comédie-Française en 1879 ; Et celui de Jean Valjean dans " Les Misérables " au théâtre de la Porte St-Martin en 1899.
Coquelin aîné fait toute sa carrière à la Comédie-Française avant de jouer sur d'autres scènes : il crée triomphalement Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, au Théâtre de la Porte Saint-Martin en 1897, interprétation que Louis Picard immortalise dans son portrait de l'artiste. |
D.
L. - CPV 155 - Club Philatélique de Vélizy
novembre 2018/janvier
2019
Documents : Daniel Liron (CPV)
Sources : Sites Comédie Française,
Wikipédia, autres
Corrections : Danièle Gasiglia-Laster,
(secrétaire de la SAVH)