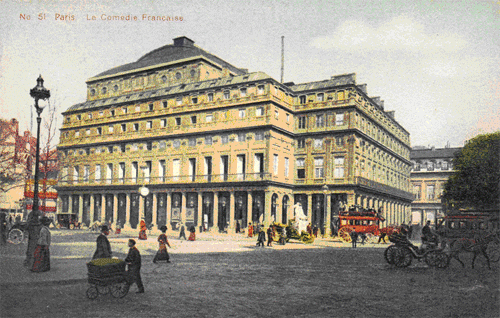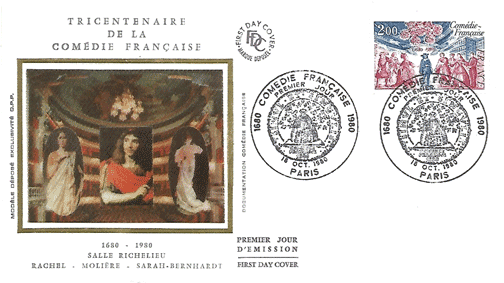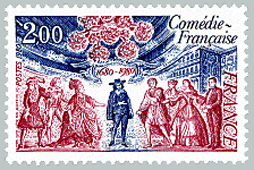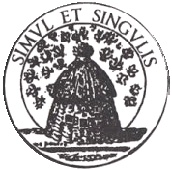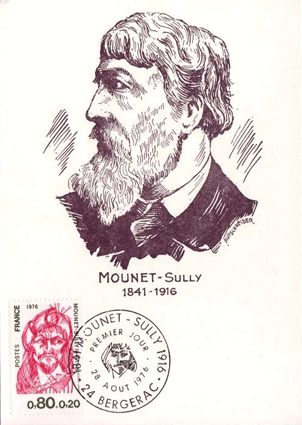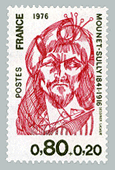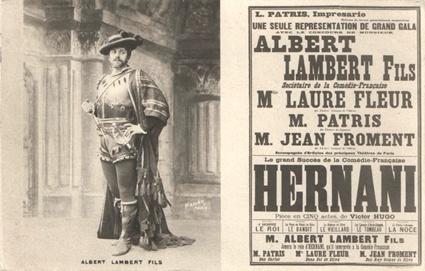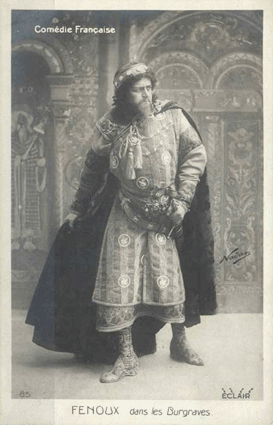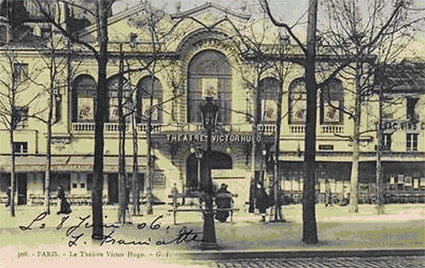LES ACTEURS
DU THEATRE DE HUGO
partie 2/2
articles parus dans les Bulletins n°136
et 138 du Club Philatélique de Vélizy-Villacoublay
et dans le n°17 de L'ECHO HUGO (2018), Bulletin de la Société
des Amis de Victor Hugo
La
Comédie Française
La Comédie-Française,
théâtre emblématique : le Français !
Théâtre
incontournable pour les comédiens. Un timbre a été émis
le 14 octobre 1980 pour les 300 ans de la Comédie Française. 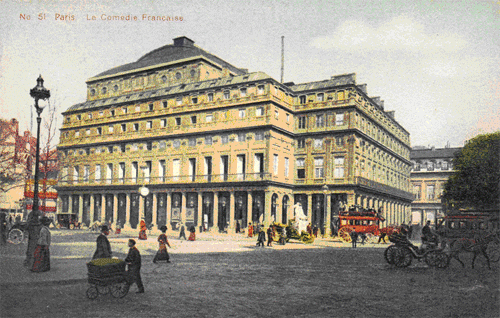
Carte
postale N°51 Paris - La Comédie Française
La
Comédie Française ou Théâtre Français (surnommé
le " Français ") est une institution culturelle française
fondée par ordonnance royale de Louis XIV le 21 octobre 1680 pour fusionner
les deux seules troupes parisiennes de l'époque : la troupe de l'hôtel
Guénégaud (troupe de Molière) et celle de l'hôtel de
Bourgogne. L'acte royal leur accorde le monopole de jouer à Paris, que
les Comédiens-Français défendront jalousement au cours du
XVIII siècle, notamment contre les Comédiens Italiens. 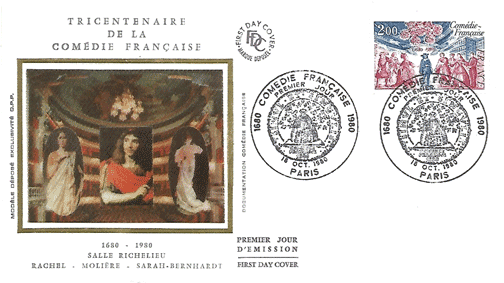
Enveloppe
1er Jour - 14.oct.1980, avec en images, entourant Molière, Rachel et Sarah
Bernhardt
Le 5 janvier 1681, les Comédiens-Français
se lient entre eux par un acte d'association qui règle notamment le régime
des pensions des comédiens retraités.
Bien que mort depuis sept
ans quand la troupe a été créée, Molière est
considéré comme le " patron " de l'institution, surnommée
la " Maison de Molière ". Le fauteuil dans lequel il entra en
agonie lors d'une représentation du Malade imaginaire est toujours
exposé au fond de la galerie des bustes, après le Foyer Public. Le
3 septembre 1793, pendant la Révolution, la Comédie-Française
est fermée par ordre du Comité de Salut Public, et les comédiens
sont emprisonnés. Le 31 mai 1799, le nouveau gouvernement met à
disposition la salle du théâtre de la République (salle Richelieu)
où jouait Talma, pour permettre aux comédiens de reconstituer la
troupe qui n'en bougera désormais plus (sauf durant les périodes
de restauration de la salle). En 1812, l'empereur Napoléon Ier, en pleine
campagne de Russie, décide de réorganiser la Comédie-Française
en signant le 15 octobre, le décret dit " de Moscou " qui comporte
87 articles, et qui reste, à peu de chose près, le statut encore
en vigueur aujourd'hui. 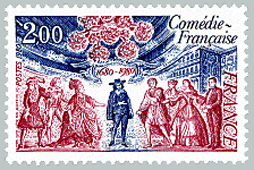 Timbre
français de 1980 Timbre
français de 1980 | 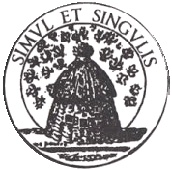 Emblème Emblème |  Jeton
de présence Jeton
de présence |
La composition du
timbre de 1980, des 300 ans de la Comédie-Française, reconstitue
l'espace de prestigieuse salle, ses balcons et ses loges, ses lumières
et son lustre. Cette grande fleur joyeuse éclaire des personnages symboliquement
regroupés sur une scène imaginaire.
Les acteurs entourent le
maître des lieux, un Scapin-Molière en costume d'époque, auquel
le regretté Jacques Charron, en frac anachronique comme pour marquer l'écart
du temps, adresse le traditionnel hommage annuel.
Un autre sacrifice de la
chronologie, pour équilibrer le dessin fait apparaître à gauche
un Figaro, entre le fidèle La Grange, en petit marquis des Précieuses,
et les falbalas de Mademoiselle Clairon, dans un rôle d'une pièce
de Voltaire.
A droite, la toge de Talma, l'acteur préféré
de Napoléon, masque en partie le péplum de la grande tragédienne
Rachel. La robe romantique venue des Caprices de Marianne illustre enfin
la comédie de Musset, mélange de fantaisie et d'émotion.
Ces
trois siècles d'un théâtre, où la tradition n'exclut
pas la recherche, aboutissent à notre Comédie-Française,
fidèle à l'esprit des grands auteurs de " la maison "
; un Molière catégorique qui dit : " La règle des règles
est de plaire ", [auquel Shakespeare semble avoir répondu d'avance
d'un titre désinvolte : As you like it, traduit par François-Victor
Hugo : Comme il vous plaira".

|
MOUNET-SULLY
: Jean-Sully Mounet dit
(27 février 1841 - Bergerac / 1er mars 1916
- Paris 5ème)
297e sociétaire
Entré à la Comédie-Française
en 1872 ; sociétaire en 1874 ; doyen de 1894 à 1916.
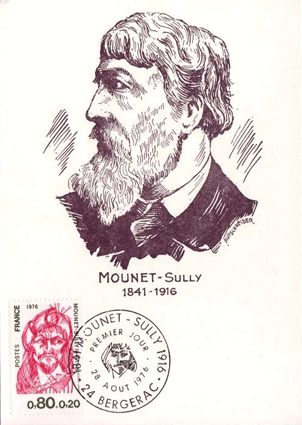
Carte-maximum
Conservatoire
dans la classe de Bressant, Jean-Sully Mounet, dit Sully-Mounet, en sort en 1868
avec un premier accessit de Tragédie et un second prix de Comédie.
Il joue, à l'Odéon, des rôles secondaires et, après
la guerre de 1870 qu'il fait en qualité d'officier, il participe aux matinées
Ballande où le remarque Émile Perrin, administrateur de la Comédie-Française.
Il
débute en 1872 dans le rôle d'Oreste, dans Andromaque, mémorable
soirée au cours de laquelle le jeune tragédien, par sa beauté,
sa fougue, sa conception du rôle obtient un succès prodigieux. Il
joue ensuite Le Cid, mais la sauvagerie de son jeu déconcerte et
il est obligé de modifier son interprétation avant de devenir "
le Rodrigue idéal ", salué par la critique.
Il s'empare
alors pour plus de vingt ans de tous les grands premiers rôles tragiques
du répertoire : Achille, Hippolyte, Néron, Joad, Horace, Polyeucte...
Il joue Orosmane, dans une reprise de Zaïre de Voltaire et donne
la pleine mesure de son tempérament dans le drame hugolien, [de Marion
Delorme (1873) aux Burgraves (1902) en passant par Hernani, Ruy Blas et Le roi
s'amuse.]
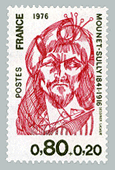
Timbre
français de 1976
De même, les fureurs shakespeariennes
conviennent à sa nature ardente : il fait un triomphe dans Hamlet,
puis dans Othello.
Doyen respecté, il se pique aussi d'écrire
et interprétera lui-même en 1906 à l'Odéon, avec permission
spéciale de la Comédie-Française, La Vieillesse de Don
Juan, pièce écrite en collaboration avec P. Barbier. Ses Souvenirs
d'un tragédien sont publiés l'année qui suit sa mort.
En 1909, il a participé aux premières expériences du Film
d'art (Le Baiser de Judas, Macbeth…). Un étonnant document
tourné pour Pathé-Journal évoque son interprétation
d'Œdipe roi.
Un médaillon, inauguré en 1927 sur
les murs-mêmes de la Comédie-Française - galerie Montpensier
-, rappelle son souvenir, seul acteur parmi les auteurs dont le profil figure
sous les galeries du théâtre.
Rôles hugoliens à
la Comédie Française :
"
1873 : Marion de Lorme : Didier
" 1877 : Hernani : Hernani
"
1879 : Ruy Blas : Ruy Blas
" 1882 : Le roi s'amuse : Français
Ier
" 1902 : Les Burgraves : Job
" 1902 : Ruy Blas
: Ruy Blas
" 1905 : Marion de Lorme : Louis XIII
" 1907
: Marion de Lorme : Louis XIII |
| ALBERT-LAMBERT
: Raphaël-Albert Lambert, dit
(31 décembre 1865 - Rouen / 1er mars
1941 - Paris)
323e sociétaire
Entré à la Comédie-Française
en 1885 ; sociétaire en 1891 ; retraité en 1935 (doyen : 1930/1931)
; sociétaire honoraire en 1936.

Albert
Lambert dans Marion Delorme
Fils d'Albert Lambert, acteur
de l'Odéon, et élève de Delaunay au Conservatoire, il fait
des débuts triomphaux à l'Odéon en 1883, dans Severo Torelli,
de François Coppée.
Presque aussitôt engagé à
la Comédie-Française, il prend possession de l'emploi des grands
premiers rôles tragiques et romantiques.
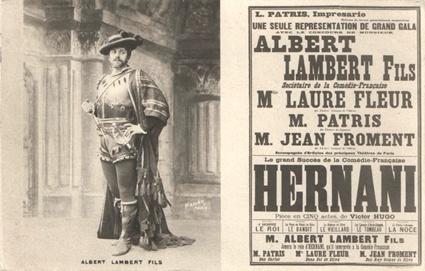
Beauté,
prestance, voix de bronze, éternelle jeunesse, toutes ces qualités
lui valent une carrière exceptionnellement longue. Son répertoire,
très vaste, marqué par les rôles romantiques (il joue Ruy
Blas pendant cinquante ans !) va des rôles antiques (Jason, Polyphème,
Œdipe, etc.) aux créations contemporaines, plus particulièrement
les fresques historico-sentimentales de François Coppée, Victorien
Sardou et Henri de Bornier. Il joue aussi la comédie de mœurs, de
Dumas fils à Henri Lavedan et à Paul Hervieu. Il laisse le souvenir
d'un Alceste exceptionnel, mais Bajazet, Rodrigue, Hamlet, Roméo, Hernani
ont aussi marqué sa carrière, qu'il termine en qualité de
doyen de la Comédie-Française.
Rôle hugoliens à
la Comédie Française :
"
1901 : Les Burgraves : Otbert
" 1905 : Ruy Blas : Ruy Blas
"
1905 : Marion Delorme : Didier
" 1906 : Hernani : Hernani
"
1907 : Marion de Lorme : Didier
" 1918 : Lucrèce Borgia
: Gennaro
" 1920 : Hernani : Hernani
" 1922 : Marion
Delorme : Didier |
Il participe, également,
aux premières expériences cinématographiques du Film d'art. | FENOUX
: Jacques Fenoux
(24 mai 1870 - Le Havre / 24 juillet 1930 - La-Seyne-sur-Mer)
343e
sociétaire
Entré à la Comédie-Française
en 1895 ; sociétaire en 1906 ; retraité en 1924 ; sociétaire
honoraire en 1925.
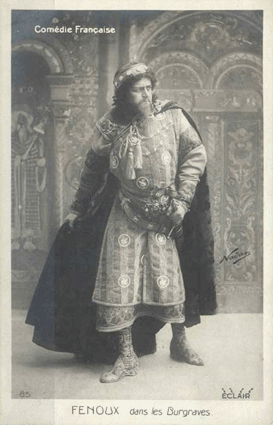
Jacques
Fenoux dans Les Burgraves
Élève de Maubert
au Conservatoire, il remporte deux premiers prix en 1893 et débute aussitôt
à l'Odéon dans Vercingétorix (Cottinet) et dans le
Fils naturel d'Alexandre Dumas fils, qu'il va jouer plusieurs centaines
de fois. Engagé à la Comédie-Française, il obtient
l'autorisation exceptionnelle de créer d'abord à l'Odéon,
Pour la couronne de François Coppée, qui remporte un très
grand succès.
C'est en 1895 qu'il débute à la Comédie-Française,
de manière un peu conventionnelle, dans Oreste d'Andromaque. Sa
voix forte et bien timbrée, sa prestance, le désignent pour les
rôles tragiques et il interprète successivement tous les héros
de Racine et de Corneille, de Rodrigue à Néron, d'Hippolyte à
Horace, etc. Il est aussi, avec l'autorité que lui confère une certaine
sécheresse, Don Carlos dans Hernani et Don Salluste dans
Ruy Blas.
Sociétaire en 1906, il aborde avec l'âge
les rôles plus marqués de la tragédie.
Après Nicomède
(P. Corneille) et Rome vaincue (Parodi), il jouera Félix dans Polyeucte
et Auguste dans Cinna, figures " romaines " qui conviennent à
son profil de médaille. Il joue avec superbe l'Almaviva du Mariage de
Figaro, la tragédie antique (également dans les représentations
en plein air), les héros modernes de Pailleron, Dumas fils, Henry Becque,
crée Le Cloître d'Émile Verhaeren, L'Hérodienne
d'Albert Dubois, L'Ennemi du peuple d'Ibsen, mais il sait aussi, dans
la comédie, donner aux personnages secondaires la touche caricaturale ou
burlesque : Oronte et Trissotin, Don Guritan (Ruy Blas), les fantoches
pittoresques de Molière et Musset...
Rôle hugoliens à
la Comédie Française :
"
1896 : Hernani : Hernani
" 1902 : Les Burgraves : Hatto
"
1922 : Marion de Lorme : M. de Laffemas |
| Un
théâtre Victor Hugo Bâti
en 1894 à l'emplacement du jardin de l'Elysée-Montmartre, sis au
80 boulevard de Rochechouart, le " Trianon-Concert ", premier nom de
la salle est détruite en partie par un incendie en 1900. Un nouvel établissement
est reconstruit et est inauguré fin 1902 sous le nom de " Trianon-Théâtre
". Rebaptisée au fil des modes et des circonstances, la salle de spectacle
se nomme successivement " Théâtre Victor-Hugo " (1903),
" Trianon-Lyrique " et enfin " Trianon ". 
Le
théâtre Victor hugo avant 1904
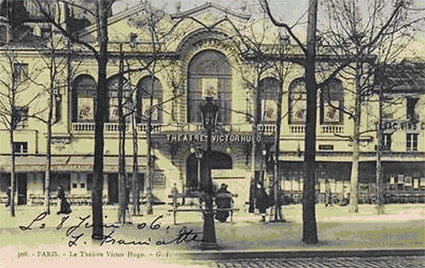
Le
théâtre Victor Hugo en janvier 1906
|
D.
L. - CPV 155 - Club Philatélique de Vélizy
novembre 2018/janvier
2019
Documents : Daniel Liron (CPV)
Sources : Sites Comédie Française,
Wikipédia, autres
Corrections : Danièle Gasiglia-Laster,
(secrétaire de la SAVH)
|